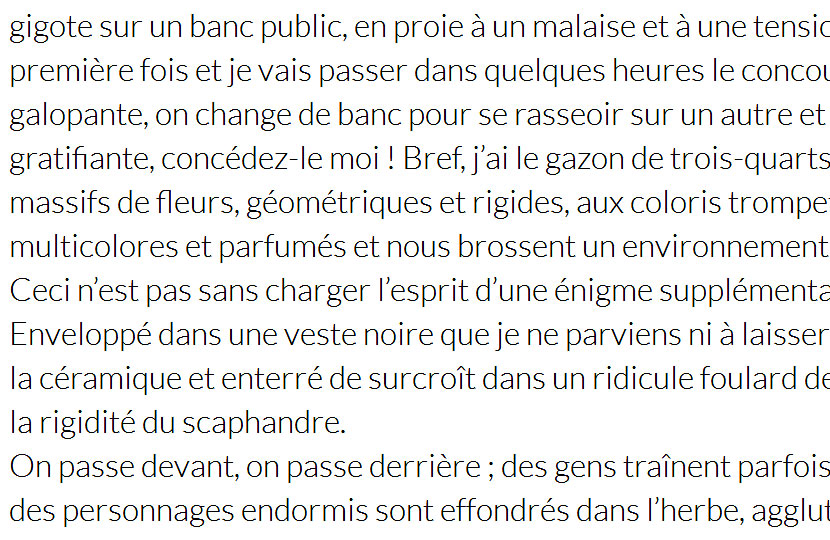Sentir entre le pouce et l’index la trépidation d’une tige de matière plastique déposant une trace qui s’allonge à l’infini en arabesques stupides s’appelle écrire… Écrire quoi, je vous l’demande. Et je ne peux vous rendre compte, lecteur crétin, que du sentiment de gêne mêlée de répulsion, pour ne pas dire de paresse, qui me laisse dans le fond de la gorge comme un sédiment tenace ; quelque chose à expulser mais qui se révèlerait en dernière analyse inexpulsable. De l’avis de quelqu’un de modeste comme moi, qu’il est, n’est-ce-pas, prétentieux d’écrire aujourd’hui ! Oui, j’ajoute bien aujourd’hui et ce n’est point un terme de trop que celui-ci. Tenez, la honte m’est là présente entre les doigts comme le trapèze de palme entre les doigts du canard. La main n’est-elle pas suffisante pour taper sur la table ! Vous faudra-t-il cogner d’un marteau ? Fermez-moi donc ça, comment peut-on encore perdre son temps à lire de pareilles conneries !
Ah ! Le pan d’un foulard raffiné quoique mité qui m’enserre grotesquement la gorge s’envole sous l’effet d’une légère bourrasque et se plaque hardiment sur ma face — ceci constitue le premier gros plan. Des étourneaux piquent maintenant bec en tête dans le gras du gazon. Ils négocient le sol sans la moindre délicatesse, tendant les ailes comme si l’on tendait un parapluie et se mettent immédiatement à l’œuvre. Spectacle pitoyable pour quelqu’un qui gigote sur un banc public, en proie à un malaise et à une tension des moins enviables (je sillonne cette ville pour la première fois et je vais passer dans quelques heures le concours de douanier, pensez!). On cède à l’agitation galopante, on change de banc pour se rasseoir sur un autre et ainsi de suite, ce qui n’est pas une activité très gratifiante, concédez-le moi ! Bref, j’ai le gazon de trois-quarts sur ma gauche au lieu de l’avoir en face, voilà. Des massifs de fleurs, géométriques et rigides, aux coloris trompettants se dressent tels des bataillons de glands multicolores et parfumés et nous brossent un environnement plat et écœurant à l’impact esthétique impénétrable. Ceci n’est pas sans charger l’esprit d’une énigme supplémentaire. L’air est frais, c’est tout ce que l’on peut dire.
Enveloppé dans une veste noire que je ne parviens ni à laisser aboutonnée ni désaboutonnée, le cou dur comme de la céramique et enterré de surcroît dans un ridicule foulard de deuil, j’ai sur la planche de bois que l’on nomme banc la rigidité du scaphandre.
On passe devant, on passe derrière ; des gens traînent parfois au bout de lanières démesurées, des chiens. Là-bas des personnages endormis sont effondrés dans l’herbe, agglutinés au fond d’une cuvette, le visage plaqué contre la terre dans le lit répugnant d’une barbe. Dans une belle neutralité, des litres de rouge briseurs d’incisives en puissance, sont tapis comme une fraîche nichée de chats éparpillés dans le gazon…
Ce n’est pas que j’ai envie de m’éterniser ici mais un espace vert au milieu de la tuerie citadine, ça reste toujours un havre de paix, allez c’est reparti jusqu’à la demie ! Conclus-je intérieurement. Mais voilà un individu qui surgit sur ma droite et qui bifurque en ma direction ; son coup d’œil rapide et pénétrant glisse au fond de moi-même, me révélant la proximité d’une créature satanique. Il fait mine de s’asseoir quelques instants, de se rasséréner olfactivement puis de contempler l’odieuse pelouse. « Quel bol d’air, en effet ! » ris-je dans mes moustaches. Mais le personnage enfin se dessine bien mieux dans mes yeux ; il s’est levé et s’est approché en me demandant l’heure puis il profite de cette diversion pour s’asseoir à mes côtés. Il engage rapidement la conversation.
— Vous avez l’air bien taciturne et vous semblez terriblement anxieux, que se passe-t-il ? Vous ne vous sentez pas bien ? Continue-t-il, me balayant de la tête aux pieds avec un regard de bombyx. Puis ne voilà-t-il pas que ce regard se pose avec insistance à l’endroit du serpent de mon entre-jambes.
— Euh, balbutié-je, euh ! Je m’appelle coq et je suis artiste-peintre, alors, pensez !… répliqué-je complètement décontenancé. Il continue avec un sourire entendu :
— Ah ! je vois…
Quelques instants de silence qui se coagule en silex puis un rayon de soleil tubulaire et unique à la faveur duquel son court veston m’apparaît mité. Je fume frénétiquement, croyant naïvement éponger de cette manière l’angoisse explosive qui me ronge. Mais ses paroles commencent à s’écrouler comme un fleuve de feu :
— Est-ce que tu te branles ?
— Euh, oui, euh…
— J’ai envie de te branler la quéquette, viens faire un tour avec moi, j’connais un coin, on va s’amuser un peu !
— Euh, non, euh, voyez bien que les choses sexuelles ne m’intéressent pas, étant moi-même engagé dans une quête spirituelle, pensez ! Complétè-je d’une voix chevrotante, les sourcils parlant de sueur et rendus contractiles par une série de spasmes nerveux, par définition involontaires.
Le coup de klaxon mat et concret d’un gros camion qui passe en bougonnant court-circuite l’énorme émotion de mon sang et précipite mon esprit dans un état d’absence. Je regarderai la pelouse fixement en feignant l’hébétude, décidé désormais à tout ignorer du monde extérieur… Mais bien vite l’homme au regard de mite attire l’attention sur lui :
— Alors, que décides-tu ?
— Quelle activité professionnelle exercez-vous au fait ? Demandè-je, tentant de faire dévier la conversation.
S’étant présenté comme agent hospitalier ayant charge de trois enfants, il me demande si je suis pour la fessée ou pour la gifle.
— La gifle constitue pour l’enfant une réprimande trop brutale voire humiliante, dit-il, il faut fesser, lui baisser le pantalon et fesser. As-tu fessé ou vu fesser un enfant ? Poursuit-il.
— Euh, oui, inventè-je, une femme, un jour, a baissé devant moi le pantalon de son bébé et lui a administré une fessée maison. Ses yeux se mettent à pétiller d’intérêt et il me demande de lui faire part de l’émotion que cette vision a pu susciter en moi.
— Intérieurement j’ai ri, ajoutè-je stupidement.
Puis il commence à m’attoucher le haut des jambes et les organes sexuels :
— Tu dois être bien monté, dit-il, allez, viens t’amuser un peu, j’connais un coin tranquille !
Mais déjà mon refus a été moins net que le précédent et la sodomie que je redoutais comme la chose la plus épouvantable au monde se présente maintenant sous des aspects plus fleuris ; j’y pressens intuitivement la déconstipation future de mon esprit. Oui, il faut que je me résolve à accepter le défi ; ne pas fuir une fois de plus ! Telle est pour l’heure la nature de ma réflexion. Mais l’homme au veston noir qui est un habile stratège a parfaitement perçu mon fléchissement : le voilà qui se lève et qui disparaît cinq minutes. Étant moi-même psychologue comme une botte de poireaux je ne m’aperçois même pas qu’il ne s’agit que d’un stratagème et je pense sincèrement à un départ définitif, je commence même à regretter d’avoir laissé passer cette chance unique d’être sodomisé. Le lecteur comprendra sans peine ma surprise à voir apparaître à nouveau notre homme de derrière un buisson, prêt à cueillir maintenant le fruit parfaitement mûr. En réanalysant bien la scène quelque temps après, je devais me rendre compte que ma vivacité d’esprit avait été à la hauteur de celle des Dupondt, ce qui est peu flatteur, convenez-en !
L’instant tragique est venu pour moi d’accepter d' »aller m’amuser », comme dit l’autre avec un inégalable cynisme. Je dois lui faire part de ma décision… Mais c’est lui qui, derechef, reprend le dialogue :
— Étant anxieux comme tu l’es…, tu prends des calmants n’est-ce-pas ? interroge-t-il, je te conseille vivement les suppositoires, c’est ce qu’il y a de plus actif, continue-t-il. Il sort de sa poche intérieure une plaquette qu’il manipule comme un objet précieux et me demande d’un hochement de tête insistant de considérer celle-ci tactilement.
— Je n’ai pas mis de suppositoire depuis ma dernière coqueluche, alors voyez si ça remonte loin, pensez ! Rétorquè-je, consentant à effleurer du bout des doigts ce qu’il me tend.
— Ah bon vraiment, fait-il avec une expression se teintant de déception. (Je comprendrai plus tard que ces suppositoires anti-spasmodiques étaient en fait destinés à procurer un relâchement rectal afin de faciliter l’intromission phallique.) Mais je me décide soudainement :
— Bon, tu veux me branler, hoquetè-je, c’est d’accord on y va, mais je te préviens : ne compte pas aller plus loin avec moi !
Une image me transporte dans une scène où, les genoux au sol et l’échine redressée, je goûte aux joies de la dilatation anale.L’endroit est charmant et consiste en un de ces réduits dédaignés par le promeneur importun, que les églises ou les presbytères abandonnés savent toujours nous offrir quand il le faut. Une tiède lumière se diffuse par une petite fenêtre moussue discrètement fêlée à l’endroit d’un de ses carreaux, fêlure qui scinde obliquement en deux la vision d’un jardin que l’on devine vert, gazouillant et radieux…
Ça y est, d’un pas rapide nous évoluons vers la sortie du parc. Bombyx, dans la silhouette de profil chavirée par la marche, a quelque chose de jeune et de digne. Nous nous bousculons légèrement entre deux troênes et déjà sa main ouverte se porte à mon derrière dont elle étreint fermement le galbe. Je me retourne avec sur le visage un de ces sourires en coin, idiot et forcé, qui n’inciterait personne à entrer en amitié avec soi-même. Le niveau sonore de la rue, puissant, se révèle aigu dans la matière cérébrale, comme la pointe d’une corne. Il faut quitter fréquemment les trottoirs encombrés où des caillots d’humains par instants, se forment. La progression est rude ; une once d’air, de vent frais serait salutaire et balaierait au moins cette fumée poisseuse d’automobile qui remplit les naseaux.
— C’est encore loin ? râlè-je alors que mon regard levé vers le ciel tombe sur la fuite de façades et d’édifices vertigineux. Le grain de la pierre, impitoyable à l’oeil, s’imprime dans l’esprit comme si j’étais capable de toucher à distance. Mais le dédale incompréhensible des rues s’épuise bientôt. Nous atteignons une bâtisse en construction, grise. Les tuiles d’un orange neuf et clair, les plages de ciment verticales et vierges, le sol rare et tassé, les seaux, pelles, poutrelles et briques donnent à l’ensemble un caractère nettement sordide. Le bassin esquivant labyrinthiquement le matériel de chantier nous filons par l’entrée qui se présente à nous comme une bouche noire. L’esprit attentif aux sons cherchant à déceler la présence d’éventuels ouvriers, s’aiguise encore. Le tunnel du sous-sol que nous explorons, finit ici dans le fond d’un couloir, dans une poche obscure…
L’odeur de ciment frais, fine mais répugnante jallit dans le silence impressionnant qui s’ouvre dans les profondeurs insondables du sol, alors que nous cherchons à tâtons où nous pouvons bien être, le temps que nos pupilles s’acclimatent…
Le déclic métallique d’une ceinture annonce un lâcher d’étoffe qui glisse le long d’un membre. C’est alors le halètement précipité d’un jeune phoque qu’on entend et le clapotis d’une verge qu’on commence à travailler. Un bras vigoureux comme la tentacule d’un boa m’enserre bientôt le bassin et commence à le dénuder. Une main à l’endroit de ma verge cherche à extirper l’ensemble de mes organes génitaux que j’appréhende comme momifié à l’intérieur d’une fontaine de bandelettes, laquelle se dévide vertigineusement. Mon corps figé dans une passivité de pierre se prête à des mains qui courent en lui comme de l’eau et du feu. L’abdication radicale de toute volonté propre qui se traduit par une totale paralysie d’action m’amène à prendre conscience de la médiocrité parfaite de ma personne et je suis troublé par un sentiment de viol.
Bombyx s’enfile un suppositoire. La chaleur du rectum commençant à le dissoudre, il recrache le projectile par l’anus sous forme de poisse glissante et s’en barbouille la raie. Son doigt pointé cette fois entre mes propres ailes du cul graisse consciencieusement, préparant un nid accueillant, surgit soudain dans mon fondement. « Penche-toi en avant » me souffle-t-il. Irriguée par un torrent de sang ma queue se dresse, persiste dans sa turgescence le temps qu’une main avide la saisisse, la décapuchonne brutalement et commence à travailler. Mais mon âme me quitte dans un saisissement de terreur : le sol et les murailles conduisent une onde sonore, une pelle vient de frapper sur la dalle de dessus, on vient de parler juste au-dessus. Bombyx, persévérant, s’évertue à m’enrober le cul dans son giron, s’impatiente de ne pouvoir me pénétrer, simule dans son exapération un va-et-vient frénétique. Son gland me lèche comme une limace.
— Enfile-moi un suppositoire ! Me souffle-t-il à nouveau, sur un mode péremptoire.
— Le cœur saturé de répulsion, je m’exécute dans des gestes d’automate. Mon ongle pique, écorche et laboure depuis le socle du coccyx jusqu’au cordon du périnée. Je cherche vrainement dans la raie répugnante le point de fuite, le cosmos où s’engouffrerait tel un bolide le satellite qui commence à chauffer au sein de mes phalanges.
— Qu’est-ce que tu fabriques bordel, tu me fais mal !
En un instant la poussée ne rencontre plus qu’une résistance dérisoire et se transforme en percée. Le doigt démarre aspiré impersonnellement dans un étroit conduit, continue jusqu’à la butée, se découvre perdu dans une vaste poche où il ne parvient à trouver trace de cloison, demeure en nageant dans ce cloaque de muqueuses vivantes et frétillantes.
— Ah les salauds ! Bande de saligauds, tu t’rends compte Marcel, peste sourdement dans le tunnel une voix qui se déplace vers nous comme une boule de feu.
Un fracas de poutrelles métalliques se fait entendre, comme une sonnerie dans nos oreilles.
— Tu t’rends compte Marcel, comme des chiens ! Rage une brute fortement moustachue qui vient de jaillir barre de fer en main tandis que nous relevons et raboutonnons piteusement ceintures et pantalons en cherchant une hypothétique issue pour fuir.
— Les fumiers, c’est une dérouillée qu’il vous faut, les salauds !
La panique m’a tout d’abord envahi ; j’ai cru perdre les jambes puis fondre sur place. Comme propulsés ensuite par une fusée derrière les fesses, en rasant les murs têtes basses et coupables nous entamons l’ascension vers le jour. On nous postillonne des injures en passant, on nous enjoint avec véhémence de décamper sur le champ. La pleine lumière nous aspire enfin à l’extérieur et nous devons à nouveau esquiver sacs de ciment et pelles et fouler de quelques derniers pas ce sol crasseux de chantier. Une voix explose encore derrière nous :
— Eh l’grand ! T’as rien volé au moins, montre tes poches !
Nous sommes absorbés par la foule de la rue dans laquelle nous nous noyons complètement.
— Je pars ! Annoncè-je à Bombyx, ramène-moi au parc initial !
Ce point de repère m’étant indispensable pour ne pas divaguer intempestivement dans la ville. Bombyx n’en continue pas moins de me peloter les fesses et de me palper les bourses.
Nous nous séparons définitivement à un tournant de rue et il s’éloigne sans se retourner, se noyant cette fois-ci seul dans la foule. Mon pas est alerte et prompt. Je lorgne d’un œil les édifices hauts en humant le bout de mes doigts qui exhale à peine une légère présence de musc. Je me mets en quête d’une fontaine où je pourrais néanmoins me laver les mains…
Octobre 1984.
Ce texte fut initialement édité en 1999 par les éditions Le Corridor Bleu. Merci au Corridor Bleu, à Konrad Schmitt, Ivar Ch’Vavar.